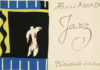À la Fondation Beyeler, l’infini se décline en points, en miroirs et en fleurs. Pour la première fois en Suisse, une rétrospective d’envergure rend hommage à Yayoi Kusama, 96 ans, artiste japonaise dont l’œuvre n’a cessé d’osciller entre hallucination et lucidité, dissolution et renaissance. Jusqu’au 25 janvier 2026.
L’exposition, conçue en étroite collaboration avec l’artiste et son studio, déploie plus de 300 œuvres venues du monde entier. Elle retrace un parcours de plus de sept décennies, depuis les dessins fragiles de Matsumoto jusqu’aux environnements monumentaux d’aujourd’hui, où le spectateur se trouve littéralement happé dans le champ visuel de l’artiste. En franchissant le seuil du musée conçu par Renzo Piano, le visiteur entre dans une expérience totale : celle d’une femme qui, depuis l’enfance, peint pour survivre à ses visions.
Née en 1929 dans une famille de pépiniéristes, Yayoi Kusama grandit entourée de fleurs et de semences. L’univers végétal devient tôt le théâtre de ses premières hallucinations : les pétales envahissent son champ de vision, se démultiplient, se répètent jusqu’à la dissolution du réel. Cette expérience fondatrice — voir le monde se couvrir d’un motif de fleurs et de points — n’a jamais cessé d’imprégner son œuvre. Elle raconte avoir compris, à cet instant, que sa mission serait de « peindre l’infini pour ne pas s’y perdre ». Ce geste inaugural, à la fois thérapeutique et métaphysique, définit une trajectoire singulière : celle d’une artiste qui fait de la répétition un langage, de la peur un moteur, de l’art un rempart contre le chaos intérieur.
À la Fondation Beyeler, l’exposition s’ouvre sur les œuvres des années 1950, réalisées à Matsumoto puis à Kyoto, avant son départ pour les États-Unis. Ces dessins à l’encre et pastels révèlent un trait déjà obsédé par la prolifération organique : yeux, fleurs, cellules, points et filaments s’entremêlent dans un désordre maîtrisé. On y perçoit le germe de tout ce qui viendra ensuite : une exploration de la frontière entre microcosme et cosmos, entre matière et esprit. Ce sont aussi des œuvres d’une rare intensité introspective — elles traduisent l’enfermement psychique d’une jeune femme dans le Japon d’après-guerre, où les conventions sociales et familiales pesaient sur toute velléité d’indépendance féminine. C’est précisément cette oppression que Kusama choisira de fuir. En 1955, elle écrit à Georgia O’Keeffe, qu’elle admire sans la connaître, pour lui demander conseil : « Comment créer librement ? Comment exister comme femme artiste ? ». Yayoi Kusama arrive à New York en 1958, avec quelques centaines de dessins roulés dans ses valises et une détermination féroce. Dans l’effervescence du downtown new-yorkais, elle se confronte à la génération de Donald Judd, Claes Oldenburg ou Andy Warhol.
Sans s’y fondre, Yayoi Kusama invente un territoire parallèle : celui d’une abstraction obsessionnelle, répétitive, qui frôle la transe. Ses Infinity Nets, peintures blanches de grand format réalisées entre 1958 et 1961, constituent un tournant. Ces toiles couvertes d’un réseau ininterrompu de petites mailles peintes à la main semblent flotter entre surface et profondeur. Leur neutralité apparente dissimule un geste compulsif, presque rituel, que l’artiste décrira comme une manière de « mesurer l’infini à partir de soi ». À travers ces trames, Kusama cherche à se dissoudre, à effacer le moi dans la répétition.
« Yayoi Kusama peint non pas des formes, mais l’expérience de leur disparition »
Donald Judd
À partir de 1961, Yayoi Kusama recouvre des objets de tissus rembourrés, créant les premières Accumulation Sculptures. Fauteuils, valises, chaussures ou canots sont envahis de formes phalliques blanches cousues main. Ce qui pourrait passer pour un jeu formel est en réalité une catharsis. Kusama y exorcise ses peurs, son dégoût du sexe masculin, tout en interrogeant le rapport au corps et au pouvoir. Elle transforme la banalité domestique en théâtre du désir et de la répulsion. En 1963, avec Aggregation: One Thousand Boats Show, elle pousse cette logique à l’extrême : un canot couvert de protubérances blanches est placé devant une photographie démultipliée du même objet couvrant les murs de la galerie. Le spectateur se trouve pris dans une boucle optique où l’objet devient image de lui-même, dans une prolifération sans fin. C’est le début de l’art immersif. Deux ans plus tard, Infinity Mirror Room – Phalli’s Field (1965) marque un basculement. Pour la première fois, Kusama crée une pièce entièrement tapissée de miroirs où le sol est jonché de formes phalliques rouges et blanches. Cette œuvre condense l’essence de son langage : la fusion du corps et de l’espace, de l’intime et du cosmique.
À la fin des années 1960, dans le Self-Obliteration Show, elle peint les corps nus de participants de pois colorés, effaçant leur individualité dans une communion sensorielle. Ses actions sont à la fois subversives et mystiques : il s’agit d’abolir les frontières entre soi et le monde. L’exposition de la Fondation Beyeler reconstitue avec précision ce parcours, tout en révélant les continuités souterraines entre les époques. Après New York, Yayoi Kusama rentre au Japon en 1973, épuisée par la frénésie occidentale et ses propres démons. Elle s’installe volontairement dans un hôpital psychiatrique à Tokyo, où elle vit toujours, continuant à travailler chaque jour dans un atelier voisin. Ce choix, souvent romancé, n’a rien d’un retrait : il témoigne d’une lucidité extrême. Kusama ne fuit pas le monde ; elle le reconstruit de l’intérieur.
Yayoi Kusama représente le Japon à la Biennale de Venise en 1993, installe ses citrouilles monumentales et multiplie les Mirror Rooms. Ses Pumpkins, jaunes et noires, deviennent des icônes de résilience : formes rondes et généreuses, elles incarnent la fertilité, la patience et la lumière. Dans les années 1990 et 2000, elle transpose ses motifs sur des structures gonflables et des environnements lumineux où le visiteur se perd dans un bain de couleur et de reflets. Ces espaces, à la frontière du rêve et du design, ont contribué à la popularité mondiale de Kusama, parfois jusqu’à la caricature. Les files d’attente pour pénétrer dans une Infinity Room ont souvent transformé l’expérience en rituel photographique, plus consumériste que contemplatif.
La Fondation Beyeler, avec son architecture transparente et ses murs de verre, devient un prolongement naturel de l’univers de Yayoi Kusama : un lieu où l’art, la nature et le corps humain se répondent. L’exposition restitue l’épaisseur d’une vie traversée par la maladie, la solitude et la persévérance. Kusama a souvent dit que peindre était pour elle une « fièvre née du désespoir ». À travers la répétition des points et des filets, elle a bâti un monde où le chaos devient ordre, où la souffrance se transforme en motif. Les grandes toiles colorées de la série My Eternal Soul, aux visages naïfs et fleurs stylisées, marquent une forme de réconciliation : le geste s’y fait plus libre, plus joyeux, presque enfantin. Ce qui frappe dans cette rétrospective, c’est la cohérence d’un œuvre pourtant multiforme. Tout chez Yayoi Kusama procède d’une même obsession, celle de se fondre dans le monde. Ses motifs incarnent un rapport au réel où chaque élément devient particule de l’univers. Le point, chez elle, est à la fois cellule, étoile et prière. Dans ses écrits, elle compare souvent le polka dot à une unité de vie : « un seul point, une seule personne, un seul moment, mais répété à l’infini ». C’est peut-être pour cela que son art touche si directement : parce qu’il parle d’effacement, de renaissance et de communion, à une époque saturée d’individualisme.
Sur le plan critique, l’exposition évite deux écueils fréquents : la fétichisation du « phénomène Kusama » et la réduction de son œuvre à un phénomène Instagram. Le choix scénographique, sobre et aéré, refuse la spectacularisation pour privilégier la contemplation. Là où les musées de Londres ou de New York avaient parfois transformé les *Mirror Rooms* en attractions, la Fondation Beyeler restitue leur dimension métaphysique. Le silence y est palpable, presque sacré. L’infini n’y est plus un effet optique, mais une présence. En cela, l’exposition réussit un pari rare : réconcilier la popularité de Kusama avec la profondeur de son œuvre. Cette rétrospective consacre Yayoi Kusama non seulement comme une artiste majeure du XXe siècle, mais comme une philosophe de la perception. Elle a transformé le motif le plus simple en système cosmique, et l’espace d’exposition en expérience existentielle. En se fondant dans les fleurs, dans les miroirs et dans la lumière, elle a su faire de la fragilité un art de vivre. Son œuvre, traversée de solitude et de joie, continue d’irradier bien au-delà des musées. À Beyeler, l’infini n’est pas une abstraction : c’est une sensation, celle d’une respiration commune entre l’artiste et le monde.