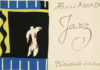Il y a, dans la peinture de Gerhard Richter, un mouvement de respiration. Une vibration lente, à peine perceptible, qui parcourt la surface des toiles comme une onde souterraine. Dans la grande rétrospective que lui consacre la Fondation Louis Vuitton, cette pulsation devient lisible, presque audible. L’exposition déploie 60 ans d’un dialogue entre le contrôle et le hasard, entre le silence et la matière. Une peinture qui s’avance avec la rigueur d’un compositeur et la liberté d’un improvisateur. Richter, à 93 ans, peint encore le monde en musicien de l’incertitude. Jusqu’au 2 mars 2026.

Huile sur toile
300 x 300 cm
Collection particulière
© Gerhard Richter 2025
Le rapprochement avec John Cage (1912-1992) s’impose, non par analogie superficielle, mais par affinité profonde. Le compositeur américain inventait des systèmes pour que la musique advienne d’elle-même. Il construisait la structure du hasard, imposait au chaos des conditions pour qu’il puisse s’exprimer. Chez Richter, la peinture devient une machine à produire de l’imprévu sous le contrôle de la main. Une “spontanéité calculée”, selon le mot que Cage aurait pu lui appliquer. Dans la série « Cage » (2006), hommage explicite au compositeur, Richter explore cette zone de tension entre structure et accident, entre la régularité du rythme et la fluidité du désordre. Comme si chaque raclage de couleur était une note tenue, chaque effacement une mesure de silence.
La rétrospective Richter qui se tient à la fondation Louis Vuitton, rassemblant 275 œuvres dans 34 salles, avance selon une chronologie qui épouse la respiration du temps. Chaque décennie devient un mouvement dans une symphonie picturale : des premiers flous photographiques aux abstractions monumentales, des portraits gris aux vibrations colorées des Strip, jusqu’aux dessins récents, derniers souffles d’un regard qui ne cherche plus à convaincre mais à persister. Cette continuité, la conservatrice Suzanne Pagé la décrit comme “une peinture encore possible” : une manière de dire que Richter ne cesse de rouvrir la question du visible, de la mémoire, du réel.
Ce que le visiteur ressent d’abord, c’est un rythme. Non celui d’une narration, mais celui d’un battement : l’alternance entre figuration et abstraction, entre effacement et apparition. Richter compose avec la répétition, la variation, la suspension. Il peint comme Cage composait : en laissant le matériau parler, en acceptant que la forme se découvre d’elle-même. Chaque toile est un champ d’expérience où la couleur s’improvise sous des contraintes strictes. Dans les Abstrakte Bilder des années 1980, les couches s’accumulent, se raclent, se répondent comme des accords dissonants. Le hasard intervient, mais sous haute surveillance. La liberté est construite. Richter déplace le pinceau comme un musicien joue avec le temps : il improvise sur une structure invisible.
“Faire quelque chose de parfait mais ne pas laisser de traces”, Richter

Chez Richter, le flou, loin d’être un effet, est une respiration. Il suspend la signification, introduit le doute, déplace le regard vers une zone d’instabilité. L’image cesse d’être souvenir ou témoignage pour devenir vibration. Loin du pathos, l’artiste installe une distance qui amplifie l’émotion. La grisaille devient un ton majeur dans sa partition. Les Graue Bilder, ces peintures neutres des années 1970, constituent une manière de silence visuel. Elles rappellent le 4’33’’ de John Cage : rien ne se passe, et pourtant tout advient dans l’attention. Le gris n’est pas absence, mais champ vibratoire. Chaque nuance contient la promesse d’un spectre.
“Tout ce que nous faisons est musique”, John Cage
Le parcours agit comme un morceau polyphonique, alternant densité et silence. Les grands formats abstraits succèdent aux portraits figés, les paysages à la limite du visible répondent aux surfaces vitrées. On passe d’une salle à l’autre comme d’un tempo à un autre, dans un équilibre toujours instable. Rien n’est figé, tout oscille. Ce mouvement perpétuel, Richter le travaille depuis toujours : il peint pour maintenir la vibration, pour empêcher l’image de se fermer. Ses toiles ne décrivent pas le monde, elles en prolongent la fréquence.
Son rapport à la musique n’a jamais été anecdotique. Les cycles Bach (1992) et Cage (2006) traduisent deux pôles : l’ordre et le chaos, la règle et l’aléatoire. Bach construit la perfection du système ; Cage, le non-système qui engendre la liberté. Richter navigue entre les deux. Son sens du rythme procède de cette oscillation : jamais tout à fait symétrique, jamais complètement désordonné. Chaque toile cherche son accord juste. Le peintre écoute la peinture. C’est en ce sens que ses œuvres sont vibratoires : elles ne se lisent pas, elles se perçoivent. Leur vérité tient à l’expérience physique qu’elles provoquent, à ce battement rétinien qui se prolonge dans le corps.

Richter orchestre une expérience optique proche de la musique répétitive : motifs, retours, déphasages. Ce que nous voyons dépend de notre position, de notre mouvement, du temps que nous mettons à regarder. L’artiste ne peint pas pour exprimer mais pour éprouver. Son agnosticisme visuel – “images de rien”, disait-il – n’est pas une négation du sens, mais une ouverture. Là où tant d’artistes cherchent la signification, il cherche la fréquence. L’image devient un champ de forces, un espace de résonance. Il ne s’agit plus de représenter le réel mais d’en faire vibrer la mémoire. D’où cette alternance constante entre abstraction et figuration : deux voies d’une même expérience perceptive.
Dans les portraits comme Betty ou S. mit Kind, l’émotion passe par le retrait, la douceur du flou, la suspension du contour. Dans les Abstrakte Bilder, elle passe par la densité du pigment, l’éclat ou l’effacement de la couleur. Même mouvement, même battement. Cette dialectique atteint sa forme la plus poignante dans Birkenau (2014). Quatre grandes toiles issues de photographies prises clandestinement à Auschwitz, entièrement recouvertes de couches abstraites. Le sujet, indicible, se dissout dans la matière. La vibration devient mémoire. Ce n’est plus une peinture sur l’irreprésentable, mais une peinture comme résistance au silence. Richter a dit avoir recouvert les images “par honte, pitié ou sentiment religieux”. Le geste est un effacement actif, une manière de faire résonner l’absence. Les miroirs placés en vis-à-vis renvoient le spectateur à lui-même : chacun devient l’espace de cette onde muette. Comme dans la musique de Cage, où le silence n’est jamais vide mais rempli de sons du monde, Birkenau fait entendre ce qui ne peut être dit.

Dans cette rétrospective d’une grande qualité « musicographique », le visiteur traverse une histoire de la peinture moderne vue depuis son envers. Richter renverse toutes les oppositions : abstraction/figuration, hasard/contrôle, émotion/système. Sa cohérence tient justement à cette oscillation permanente. Il ne choisit pas, il conjugue. Il peint l’indécidable. Cette posture, éthique autant qu’esthétique, fait de lui un peintre du doute, mais d’un doute actif, fécond. Chaque œuvre affirme la possibilité de continuer à peindre après la perte des certitudes. “Donner une image du monde”, disait-il. Mais le monde n’est pas représenté : il est mis en vibration. Dans le parcours de la Fondation Louis Vuitton, on perçoit cette temporalité élargie : les débuts gris et les abstractions flamboyantes se font écho. Chaque salle est un intervalle, chaque décennie une modulation.
L’expression “spontanéité calculée” résume toute la méthode de Richter. Elle éclaire cette tension entre hasard et maîtrise qui fonde son rapport au monde. L’artiste ne cherche ni à imposer sa volonté ni à s’effacer complètement : il orchestre. Il laisse la matière produire ses propres rythmes, mais selon une structure pensée, réglée, minutieuse. C’est cette cohabitation entre rigueur et lâcher-prise qui donne à ses œuvres leur pouvoir hypnotique.
INFOS PRATIQUES
Exposition : Gerhard Richter
Lieu : Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, Paris 16e
Dates : du 17 octobre 2025 au 2 mars 2026
Commissariat : Suzanne Pagé (direction artistique), Dieter Schwarz et Nicholas Serota (commissaires invités)
Œuvres exposées : 275 pièces — peintures, sculptures en verre et en acier, dessins, aquarelles, photographies peintes — couvrant soixante ans de création (1962-2024)
Horaires : tous les jours sauf mardi, de 10 h à 20 h ; nocturne le vendredi jusqu’à 22 h
Billetterie : en ligne sur fondationlouisvuitton.fr
Autour de l’exposition :
Programmation musicale en écho à la série Cage (2006)